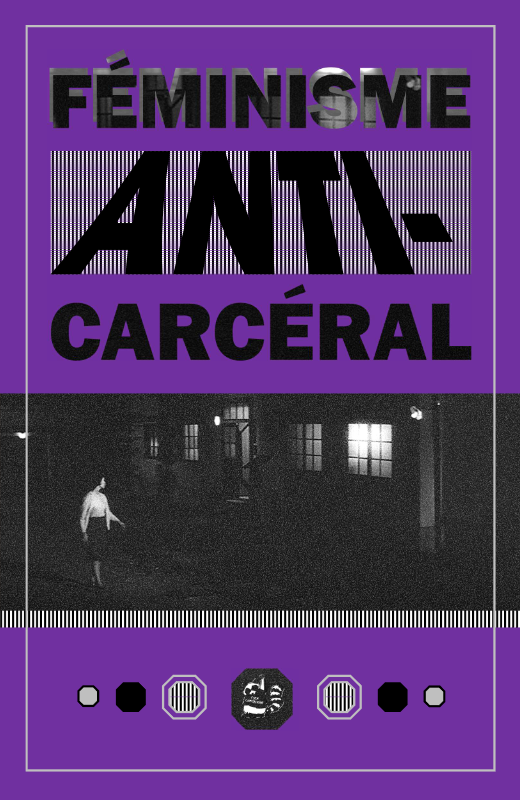L’asexualité et la politique féministe de « ne pas le faire »: Chapitre 3 : Produire des histoires : l’asexualité féministe et la politique de « ne pas le faire »
Traducteurices : Ellyndia et Al Loustoni
“Nous pensons que nous avons besoin de sexe, mais la question est très confuse. De quoi a-t-on vraiment besoin ? Des orgasmes ? Du rapport sexuel ? De l’intimité avec un autre être humain ? Des caresses ? De la compagnie ? De la gentillesse humaine ? Et en avons-nous « besoin » physiquement ou psychologiquement ?” - Dana Densmore, « Independence from the Sexual Revolution », 1971, p.59
Comme je l’ai déjà mentionné dans le chapitre précédent, l’asexualité contemporaine, est une entité sexuelle entièrement nouvelle et unique, qui est façonnée par un échange, un dialogue entre la science, la popularisation de la science par les médias et les efforts des activistes asexuel-le-s. Cependant bien que l’asexualité n’a jamais existé auparavant de la manière qu’elle existe aujourd’hui, en tant qu’identité sexuelle bourgeonnante, elle est apparue historiquement via diverses formes. Manque de passion, frigidité, célibat – bien que pas de l’asexualité en soi, sont néanmoins tous pertinents pour une considération historique de « ne pas le faire ». En traquant les formes historiques de l’asexualité un ensemble d’éléments deviennent clairs. Premièrement, le sens de l’asexualité change avec le temps, de pair avec les discours qui lui donnent sa forme. Ainsi il est possible qu’à un moment historique l’asexualité soit comprise comme une sorte de norme pour les sexualités des femmes [1], alors qu’à un autre moment ça ne le soit pas. C'est parce que l’asexualité des femmes n’est pas un discours dominant aujourd’hui (bien que ce ne soit pas un discours mort non plus) il est possible pour les femmes de se définir asexuelles d’une façon qui n’a jamais été possible par le passé. Deuxièmement, comme le titre de chapitre l’indique, il y a toujours une politique à l’œuvre derrière « ne pas le faire », comme il y en a une derrière « le faire ». Ainsi, les standards et les normes qui ont circulé sont pris dans une politique de genre, de race et de classe.
Je commence ce chapitre en considérant d’abord, dans « Les femmes et l’asexualité », les façons dont les discours sur l’asexualité des femmes ont changé, de façon à ce que les femmes soient à un moment considérées comme n’ayant pas de désir sexuel, tandis qu’à un autre leur manque de désir sexuel soit compris en des termes pathologiques – comme la frigidité. En d’autres mots, tandis qu’au dix-neuvième siècle les femmes étaient généralement vues comme asexuelles ou sans passion, au vingtième ce discours a commencé à disparaître et les femmes sont devenues de plus en plus perçues comme des être désireux sexuellement. En conséquence, une absence de désir sexuel devient perçue péjorativement comme de la frigidité, et comprise comme ayant besoin d’une attention médicale. En suivant de tels changements dans les compréhensions des sexualités féminines, il devient évident que « ne pas le faire » pour les femmes est à la fois culturellement contingent et politiquement chargé. Ensuite dans « les asexualités féministes », je considère comment les féministes du mouvement de libération des femmes ont répondu à ces discours croissants sur la sexualisation des femmes et ont théorisé l’asexualité et le célibat pour leurs propres intérêts, comme des stratégies pour gagner l’indépendance des hommes et en finir avec l’oppression des femmes. Dans le contexte du tournant permissif des années 1960, des féministes comme Dana Densmore et Valerie Solanas ont imaginé « ne pas le faire » comme une réponse radicale et politique aux discours qui impliquaient la disponibilité sexuelle des femmes et circonscrivaient l’autonomie corporelle des femmes. Je lis ces articulations féministes de l’asexualité avec l’intention d’observer comment elles perturbent les discours dominant sur la sexualité que j’ai discutés dans le premier chapitre, notamment l’injonction au sexe et le cluster hétéro-coïtal ; de même que comment les asexualités féministes, bien que certainement différentes de l’asexualité contemporaine, sont pertinentes pour les féministes théorisant l’asexualité dans le nouveau millénaire.
I – Les Femmes et l’Asexualité : des Perspectives Historiques
L’asexualité, comme je l’explore dans cette section, a une histoire discursive qui l'intègre à la féminité. Bien que cette section soit loin d’être une revue complète des discours qui ont conçu l’asexualité féminine historiquement, elle a pour but de montrer que (1) les modalités de « ne pas le faire » changent dans le temps, (2) les discours qui conçoivent l’asexualité des femmes sont plus importants à certains moments qu’à d’autres, et que (3) « l’asexualité » – bien que relevant d’une certaine particularité aujourd’hui – porte en elle une histoire discursive. Cette histoire discursive, crucialement, place “ne pas le faire” comme quelque chose qui a un sens et une pertinence uniques pour les femmes.
En particulier, donc, je considérerai deux articulations historiques de « ne pas le faire » : le manque de passion et la frigidité. Le manque de passion désigne la croyance en l’asexualité des femmes qui fonctionnait comme discours dominant de la compréhension des sexualités féminines à la fin du XVIIIè et au XIXè siècle (Cott 1978). La frigidité, de l’autre côté, opéra surtout dans l’entre-deux-guerres alors que les discours de la capacité des femmes à ressentir le plaisir sexuel se rependaient. Indubitablement, de tels discours de l’asexualité ont concerné à un certain type de femme historiquement, chargés comme ils le sont de présomptions basées sur la classe et la race. Le manque de passion, par exemple, renseigne sur les notions de sexualités blanches, riches, tandis que les femmes ouvrières, immigrantes, ou racisées étaient considérées comme licencieuses et disponibles sexuellement (D’Emilio et Freeman 46). Aussi, le manque de passion comme la frigidité étaient utilisés à des moments de grand changement culturel, et bien ancrés sur la différence sexuelle et les sexualités féminines ; en d’autres termes, ils étaient saturés de politique de « ne pas le faire ». Et, de tels discours historiques de l’asexualité des femmes se sont révélés être à la fois contraignants et favorables, en cela qu’ils limitaient les expériences féminines de la sexualité tout en faisant de ces limites la base d’autres possibilités.
Nancy F. Cott (1978), dans une considération féministe de l’histoire de la sexualité, discute la manière dont les femmes européennes au XIXè siècle étaient considérées « sans passion » ou « anesthésiées » sexuellement avant la « science moderne » de la sexologie. De façon nette, le manque de passion référait principalement aux femmes riches, et non aux classes inférieures ou aux prostituées qui étaient perçues comme « basses et immorales », comme le gynécologue William Acton les décrivit en 1857 (212). Thomas Laqueur (1990) soutient que le manque de passion était lié à un changement culturel dans la compréhension de la sexualité d’un « modèle à-un-sexe » où les biologies féminines et masculines étaient vues comme fondamentalement similaires, bien que hiérarchiques, à un « modèle à-deux-sexes » où les femmes et les hommes étaient considérés comme fondamentalement différents en biologie et en sexualité. Tandis qu’un modèle « à-un-sexe » était accompagné d’un modèle « à-deux-graines » de reproduction, lequel présumait que le plaisir et le désir sexuel des femmes était nécessaire à la procréation, un modèle à-deux-sexes ne l’était pas. Laqueur corrèle également la primauté croissante du modèle à-deux-sexes avec de plus larges changements culturels comme l’essor de l’Evangélisme, les idéaux postrévolutionnaires, l’idéologie des sphères séparées, le régime des usines, l’économie de marché, etc., tous permettant la transformation de la compréhension du corps :
« La nouvelle biologie, avec sa recherche des différences fondamentales entre les sexes, de laquelle le questionnement torturé de l’existence même du plaisir sexuel était une partie, émergea au moment précis où les fondations de l’ancien ordre social furent ébranlées une fois pour toutes. (11) »
Carl Degler (1974), cependant, explique que bien que les hommes de médecine ont été convaincus de l’anesthésie sexuelle des femmes, ce n’était en fait pas le point de vue dominant du monde occidental. Donc bien que le praticien William Acton (1857) fut largement cité dans le monde anglophone pour sa croyance que les femmes n’étaient pas sexuelles – que « la majorité des femmes (heureusement pour la société) ne sont pas vraiment troublées par une quelconque sensation sexuelle d’aucune sorte » et avaient une « répugnance naturelle pour la cohabitation »- il n’y avait en réalité pas de réel consensus sur la question ni en médecine, ni dans la société en général (Acton 212, 214). Cela démontre qu’à tout moment des discours concurrents et dissonants sur la sexualité sont exploités, si bien que « aux XVIIIè et XIXè siècles, et en effet aujourd’hui, quelque soit la connaissance scientifique, une large variété d’affirmations culturelles contradictoires sur la différence sexuelle sont possibles » (Laqueur 175).
Le manque de passion, bien qu'« exagérant l'importance du sexe au point d’immobiliser les femmes », fournit aussi des opportunités aux femmes pour se comprendre au-delà du sexe de leurs corps (Cott 236). Elle permit aux femmes « d’affirmer un contrôle dans l’arène sexuelle » et « servit les intérêt plus larges des femmes en minimisant leur caractérisation sexuelle, qui était la cause de leur exclusion de la catégorie « humaine » (c’est-à-dire, les Hommes) » (233). Désaccentuer la sexualité a donc élevé les femmes à une sorte d’égalité morale avec les hommes (Cott 228, aussi D’Emilio et Freedman 71). De manière significative, la conviction que les femmes étaient sans passion a pu en réalité permettre à certaines femmes de refuser du sexe non voulu, limiter la taille de la famille, et créer des liens forts avec d’autres femmes dans un contexte culturel où le mariage et le travail reproductif étaient idéalisés comme les chemins de vie appropriés pour les femmes (Cott 234, 223 ; D’Emilio et Freedman 71).
A la fin du siècle cependant, les discours de l’asexualité des femmes ou du manque de passion étaient quelque peu en train de disparaître. Bien qu’Acton a suggéré que les femmes n’étaient pas intrinsèquement sexuelles, au tournant du siècle suivant Havelock Ellis (1903) était convaincu de « combien l’impulsion sexuelle est naturel chez les femmes » (Ellis 284). Ellis était catégorique à propos de la capacité des femmes à apprécier l’élan sexuel, et de « l’anormalité » de ces femmes qui montraient un désintérêt ou une anesthésie sexuelle (Ellis 284). Le plaisir sexuel devint compris comme quelque chose de naturel pour les femmes. Ce changement dans les discours de la sexualité des femmes n’était pas, cependant, une substitution claire d’un discours à un autre. A la fin du XIXè siècle le sexe devint plus central dans la compréhension de soi que jamais auparavant – avec la naissance moderne de « l’homosexualité » et de « l’hétérosexualité » d’ailleurs – comme l’explique Foucault (1978). Cependant, cela ne signifiait pas que les femmes étaient soudainement envisagées comme clairement sexuelles (c’est-à-dire, comme capable de désir et plaisir sexuel), et que les discours de l’asexualité des femmes se sont soudainement éteints.
Par exemple, Joanna Bourke (2008) mentionne que « l’avis général que les femmes étaient plus réticentes au sexe que leurs maris » a bien persisté jusque le XXè siècle et s’est attardé jusqu’au années 60 (435). Même les manuels de conseils maritaux des années 50 continuent à démontrer la vivacité des discours de la passivité sexuelle féminine ou de leur relative asexualité, et c’est à une période où le travail de Kinsey, qui soulignait la capacité des femmes au plaisir sexuel, était bien connu (Gavey 116-117). Aujourd’hui, on peut voir que les discours sur la passivité sexuelle des femmes sont toujours opérants via des croyance comme celle du avoir/garder que j’ai discuté dans le premier chapitre (où le sexe est pour les femmes un moyen d’arriver à une fin, avoir un mari, une famille et des enfants) ou avec le récent changement de la sexologie vers le modèle de réceptivité de la sexualité féminine, que j’ai mentionné dans le deuxième chapitre (Hollway; Gavey; Potts 2002; Basson 2000, 2001; Tyler). Comme l’explicite Annie Potts : « les discours permissifs gardent des notions de la sexualité masculine active et de la sexualité féminine docile, avec les femmes qui « aspirent » à satisfaire les « besoins » sexuels masculins, et risquent à chaque réticence de leur part d’être étiquetées « rigides » ou « frigides »» (2002, 44). Donc, bien qu’il y ait un virage général dans les discours dominants au fil du temps, et spécifiquement à la fin du siècle, du manque de passion des femmes à la sexualisation des femmes, les discours sur la passivité sexuelle des femmes continue exister en parallèle des discours sur le désir sexuel des femmes, même jusque dans le temps présent. Les discours se chevauchent donc, changent, formes de nouvelles constellations, mais ne disparaissent pas simplement d’une période à l’autre. Dans leur introduction de Intimate Matters (1988), John D’Emilio et Estelle Freedman décrivent cela comme un processus de superposition, selon lequel certains motifs persistent d’une ère à la suivante et sont graduellement remplacés par des nouvelles idées, préoccupations et discours (xix).
Néanmoins, il y avait une sexualisation générale des femmes à la fin de l’ère victorienne, et les sexologues, comme je l’ai démontré plus tôt avec Ellis, ont souligné la capacité des femmes au plaisir sexuel, à la jouissance, et à l’orgasme. « Le passage […] du schéma du XIXè siècle des sphères séparées entre les sexes et du manque de passion des femmes vers le schéma moderne du mariage d’amour avec un minimum de plaisir sexuel féminin » a marqué un changement discursif radical dans la compréhension de la sexualité des femmes (Vance 14). Là encore, une certaine forme de manque de passion a persisté dans l’imaginaire culturel, mais les discours dominants de la sexualité des femmes soulignaient les potentialités sexuelles féminines, leur désir et leur plaisir sexuel.
Ainsi, cette nouvelle emphase sur la naturalité du plaisir sexuel des femmes a fonctionné, en partie, de façon prescriptive, encourageant certaines formes de sexe (l’hétérosexualité coïtale) et médicalisant, dans une certaine mesure, ces femmes qui n’étaient pas intéressée par le sexe, ou le type de sexe proposé. Ellis, par exemple, souligna « l’anormalité » de ces femmes qui montraient un désintérêt ou une « anesthésie »sexuelle (Ellis 284). Ainsi, selon ces logiques culturelles, « pour être « normale », les femmes devaient avoir des rapports sexuels de leur plein gré », ce qui veut dire que non seulement le sexe hétéro-coïtal était un impératif, mais que de façon croissante, le plaisir sexuel était en train de devenir un impératif (Jeffreys 185). La féministe Margaret Jackson (1994) explique que,
“Bien que les femmes étaient désormais autorisées à avoir des sensations sexuelles et à connaitre le plaisir sexuel, c’était strictement selon les conditions masculines. […] L’instinct sexuel d’une femme ne pouvait être réveillé, et satisfait, que par un homme, rendant ainsi les femmes sexuellement dépendantes des hommes précisément à cette période de l’Histoire où elles étaient en train d’atteindre un degré significatif d’indépendance politique, économique, et sexuelle.” (179)
Dans ce contexte de prescription relative du sexe et de médicalisation de manque sexuel, le concept de frigidité devint un terme cynique culturellement disponible pour être utilisé contre ces femmes qui n’aimaient pas « le faire » pour une raison ou une autre. A travers « l’abstinence et la frigidité, le sexuel [était] rendu omniprésent, indéniable, obligatoire; un fait, une chose, un impératif » (Moore 189).
Cette tendance vers une problématisation du corps féminin non sexuel est employé encore plus intensément après la première guerre mondiale. Les féministes Margaret Jackson (1994) et Sheila Jeffreys (1985) parlent chacune de la montée de la “femme frigide” dans la littérature sexologique comme étant généralement nuisible aux femmes car cela réitéra l’injonction à l’hétérosexualité coïtal. La frigidité, bien sûre, s’appliquait strictement aux femmes et était définie en des termes hétérosexuels comme une sorte d’indifférence au sexe hétérosexuel et une attitude général de froideur – « c’était assez simplement l’échec de la femme à répondre avec enthousiasme à une pratique sexuelle particulière, le coït »(Jeffreys 171-172). En tant que philosophe féministe, Elizabeth Grosz écrit:
“Il faut noter que la frigidité n’est pas le refus du plaisir sexuel en tant que tel. C’est le refus d’un plaisir sexuel génital et orgasmique spécifique. La dite “femme frigide” est précisément la femme dont le plaisir ne rentre pas parfaitement dans la structure du plaisir sexuel définie par l'homme, une structure téléologique orientée vers un but orgasmique.” (1989, 133)
Et dans le même temps, c’était les femmes blanches de classe moyenne qui étaient incluses dans le concept de la frigidité, puisque les femmes non blanches, pauvres ou orientale étaient perçues comme lascives, sensuelles et « primitives » (Jeffreys 178-179). Dans un article récent, Alison Moore et Peter Cryle (2010) avancent que l’histoire de la frigidité est souvent simplifiée et rendue moins compliquée pour servir des objectifs politiques contemporains. Ils prouvent que le terme n’a pas simplement été créé d’en haut par des médecins comme outil contre les femmes, mais que son histoire est plus ambiguë et compliquée. Par exemple, ils examinent comment Jean Fauconney, docteur sans formation médicale, a abondamment écrit sur la frigidité à la fin du 19ième siècle en France, en mélangeant culture scientifique et culture populaire de la notion de frigidité qui prenait forme à l’époque. De plus, Moore et Cryle arguent que la frigidité a vu le jour grâce à la négociation de nombreux discours, et ne marque pas simplement le passage d’un consensus sur l’asexualité des femmes à une emphase sur leur plaisir sexuel. Alors que pendant l’entre-deux guerre, comme je l’expliquerai brièvement, la frigidité des femmes est devenue liée à un sexe qui n’était pas coital, à la fin du siècle, alors que le terme commençait à s’infiltrer dans l’usage courant, la frigidité devint une notion plus compliqué, et « était plus souvent défini comme un échec à être excitée tout court » (251). Au début du siècle, la frigidité n’était pas particulièrement médicalisée, elle commença à être de plus en plus présentée comme aberrante ou névrotique dans l'entre-deux-guerres (243). De façon intéressante, pendant l’entre-deux-guerres, la frigidité était représentée dans un langage hautement politique, reflétant les inquiétudes suscitées par l’évolution des rôles sociaux des femmes. Par exemple, Weith Knudsen (1928), qui a écrit à propos de « la question féminine », décrit la frigidité des femmes comme « une menace pour la civilisation », alors que le sexologue et l’eugéniste Walter Gallichan (1927, 1929), reliait directement au féminisme le fait que les femmes soient « froide », « prude » ou sexuellement apathique (Knudsen, qtd. in Jeffreys 176; Jackson 1994, 177-179). Gallichan avertit que « ces femmes dégénérées sont une menace pour la civilisation », qu' « elles détruisent le bonheur conjugal », qu’elles ont en fait une maladie et qu’elles ont besoin d’un traitement médical (qtd. in Jackson 1994, 177). De la même façon, Wihelm Stekel (1929), un psychologue et disciple de Sigmund Freud, écrit à propos de la frigidité en 1926 et était également convaincu que cela nécessitait des soins médicaux. Alors que Stekel a évalué que le taux de frigidité chez les femmes était très élevés et qu’il a décrit de nombreux cas de femmes qui ont eu du plaisir sexuel grâce à des étreintes passionnées, la masturbation ou une « stimulation » génitale (mais non grâce au coït), il ne perçoit pas cela comme une spécificité de la sexualité féminine, mais comme une dysfonction qui doit être réparée (voir Stekel, chapitre 5). Encore une fois, la frigidité n’était pas définie comme une incapacité totale à éprouver du plaisir sexuel, mais plutôt comme une incapacité à tirer du plaisir grâce au coït (Moore et Cryle 261). De même, Freud écrit dans ses traités sur la sexualité féminine des années 20 et 30 que la frigidité implique un échec de la femme et de la névrose; la frigidité vaginale indiquait l’incapacité des femmes a passer de l’orgasme clitoridien “immature” à l’orgasme vaginal plus mature et féminin (Gerhard 2001, 39-43). Tandis que, selon Freud, le désir sexuel originel de la petite fille était homosexuel et dirigé vers sa mère, la maturité et l’entrée dans la féminité recquirait un transfert de ce désir sur les hommes. Dans ce récit, les femmes sont à la recherche du pénis qu’elles réalisent ne pas posséder en le voyant au moment fatidique du rapport, et désire des enfants à la place comme un moyen d’avoir leur propre petit pénis (en ayant un fils) (voir par exemple « De la sexualité féminine » de Freud, 1931). L’hétérosexualité coïtale a été érigé par Freud comme la forme normale, mature et appropriée d’avoir du plaisir pour les femmes; et la maternité, comme seul chemin de vie convenable. De ce fait, le travail de Freud a naturalisé l’hétérosexualité, la reproduction et la division sexuée des corps et des rôles sociaux (Gerhard 2000, 450).
D’autre part, la frigidité, ou la frigidité vaginale, avait pour but de définir non seulement la femme mal-saine, psychologiquement malade ou névrosée, mais aussi la femme qui refusait d’accepter la fatalité de sa féminité dans sa vie. Plus que tout, l’émergence de la frigidité féminine comme un corps nécessitant une intervention médicale révèle le malaise que génère les femmes qui « ne le font pas » correctement, pas dans une relation hétérosexuelle ou assez fréquemment. Alors que la notion de frigidité féminine circulait, le célèbre manuel de mariage du physicien allemand Theodoor Van De Velde (1926) mettait en avant l’importance du mariage entre concubins, de l’orgasme simultané et de la réciprocité du plaisir sexuel pour les deux partenaires. Ce manuel démontre que le plaisir sexuel des femmes et l’orgasme féminin étaient de plus en plus souvent vu comme naturel et comme le but d’une cohabitation sexuelle, ou que le plaisir sexuel est devenu un impératif pour les femmes. Pourtant, la féministe Jane Gerhard explique dans Desiring Revolution: Rewriting of American Sexual Thought, 1920 to 1982 (2001) que cette emphase sur l’orgasme féminin n’a pas beaucoup affecté les arrangement matrimoniaux ou le role social de l’épouse subordonnée à l’autorité masculine (26). Les femmes ressentent du plaisir sexuel, mais parce que le mari en est à l’origine et a conservé son rôle d’autorité dans la maison, ce « récit de l’hétérosexualité romantique fonctionne à la fois pour améliorer et circonscrire le statut sexuel des femmes » (Gerhard 2001, 26)
De telles conceptions de la frigidité d’après guerre, et ce que soutient Jeffreys avec insistance est « une campagne massive menée par les sexologues et les rédacteurs de conseils en sexologie pour convaincre les femmes de se marier et s'assurer qu'une fois dans le mariage, elles s'engageraient joyeusement et fréquemment dans des rapports sexuels » pourrait être en partie expliquée par la discussion de Susan Kingsley Kent (1988) sur la mort du féminisme (Jeffreys 166). La problématisation et la pathologisation de la frigidité féminine dans les années 20 pourraient donc être liées à l’évolution de l’acception du mariage et du rôle maternel des femmes par la décennie, nés de la volonté nationale de retrouver un sentiment de stabilité après le chaos de la guerre. Car ce chaos a également été perçu en dehors des champs de bataille, par la présence accrue des femmes dans des travaux dits masculins. Moore et Cryle écrivent, par exemple, que « la femme frigide était perçue par beaucoup comme un danger pour la santé reproductive de la nation » (2010, 261). Ainsi, la circulation de ce concept de frigidité était révélatrice des inquiétudes à l'égard de la présence de femmes célibataires à des postes bien payé, de leur visibilité accrue dans l’espace publique et de la menace que cela représentait pour l’ordre patriarcal et la place traditionnelle des femmes dans le monde (Jackson 1994, 179).
De même, les années 30 se sont révélées être une décennie de chaos, caractérisée par une grande crise économique, accompagnée d'efforts continus pour réaffirmer les rôles sociaux et sexuels traditionnels des femmes afin de conserver un certain degré de stabilité. Les psychanalystes après Freud ont continué à se concentrer sur la frigidité et l’orgasme clitoridien, problématique ou pas assez féminin, mature. De manière plus prononcée, les psychanalystes Eduard Hitschmann et Edmund Bergler décrivent la frigidité comme « l’incapacité de la femme a avoir un orgasme vaginal » dans Frigidity in Women: Its Characteristics and Treatments en 1936 (20). Gerhard affirme que comme dans le passé, cette frigidité concernait bien plus que le renforcement des relations sexuelles coïtales, mais aussi la démarcation entre la déviance et de la normalité, de la rareté et de l'excès (2001, 40). Comme les précédentes conceptions psychanalytiques de la frigidité, sa fonction est de réaffirmer la « sanité »de la féminité passive,
“et de prévenir du chaos que représenterait des femmes se comportant comme des hommes, les accablant et rejetant leur destin passif et maternel. Désirer la stimulation clitoridienne représentait une forme d’anarchie sexuelle pour les femmes et, en le faisant, disparaissaient socialement.” (41)
Ainsi, comme je l’ai souligné, la frigidité n’opère pas seulement sur le plan sexuel, mais aussi sur le plan social, politique, c'est-à-dire qu’elle renforce les idéaux traditionnels de différence sexuelle au sein de la famille et au-delà, pendant une période d'instabilité, illustrant l’affirmation de Laqueur que « le sexe est explicable uniquement dans le contexte des combats sur le genre et le pouvoir » (11).
J’ai longuement discuté des discours sur l’asexualité ou l’absence de désir féminin, le tournant de la sexualisation des femmes et la disponibilité du concept de frigidité pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cette trajectoire que j’ai esquissé nous rappelle l’association historique de l’asexualité aux femmes. Cette association discursive est significative car elle est dissonante avec la spécificité de notre “maintenant” particulier, parce que les femmes ne sont plus à priori perçue comme asexuelles, elles peuvent s’approprier l’asexualité comme une position subversive. En d’autres termes, si les notions d’asexualité et de féminité sont encore confondues sur un plus discursif, cette vision n’est peut-être pas aussi dominante qu’elle l'était par le passé. Ainsi, j’ai aussi expliqué que la manière dont historiquement les femmes et l’asexualité ont été discursivement superposées suggère que les discours sur l’asexualité féminine changent sans jamais disparaître complètement. Si la perception des femmes comme sans désir s’est peut-être estompée, les discours sur la passivité ou la réceptivité sexuelle des femmes continuent de circuler, même de nos jours. De même, les discours qui permettent de conceptualiser la frigidité des femmes continuent de prospérer, ce qui permet au terme de rester culturellement disponible, même si légèrement différent en sens que son acception historique. Enfin, cette histoire que j’ai déroulée alimente la section suivante de ce chapitre, car, comme le soutient Gerhard, les notions de sexualité et de frigidité féminine ont galvanisé les réponses féministes de la fin des années 70 et début 60 (2001, 44). Dans la section suivante, j’examinerai comment les féministes se sont approprié les notions d’asexualité des femmes à leurs propres fins, en la mobilisant comme une méthode pour résister au patriarcat et aux demandes des hommes sur leur temps et leur corps.
II. Des Asexualités Féministes
Dans les années 50, le travail d'Alfred Kinsey et le déclin de l’hégémonie de la psychanalyse conduit à de nouvelles théorisations de l’asexualité des femmes. Kinsey, pour sa part, s'est abstenu d'employer à la fois la psychanalyse et les notions de frigidité dans son travail, expliquant son dégoût pour le terme en raison du fait qu’il impliquerait que les femmes soient moins sensibles aux stimuli sexuels que les hommes, une notion avec laquelle il était largement en désaccord (1953, 373). De manière encore plus prononcée, les sexologues William Masters et Virginia Johnson (1966) insistent sur les similarité entre les sexualités des hommes et des femmes, en mettant en avant la similitude de leur cycle de réponse sexuelle et dans le fonctionnement d’un clitoris et d’un pénis. Masters et Johnson arguent que le clitoris est l'épicentre de l’orgasme et du plaisir féminin (alors même qu’iels encouragent de manière contradictoire le sexe pénétratif), et que les femmes sont capables d’orgasmes multiples et séquentielles (voir Irvine, chp. 2 et Gerhard 2000). Les femmes étaient donc de plus en plus souvent considérées comme aussi désireuses sexuellement, capables d'excitation sexuelle et d’orgasmes que les hommes.
Avant d'entreprendre une exploration des asexualités féministes, je souhaite détailler le paysage discursif et historique des années 60. J’ai déjà mentionné le travail de Masters et de Johnson en particulier, et celui de Kinsey avant elleux, a contribué en grande partie au « virage permissif » qui a remis en cause le puritanisme culturel autour du sexe et de la sexualité (Gavey 106). Gerhard explique qu’« il y avait ici une période de la fin des années 1960 au début des années 1970 où le sexe importait d’une toute nouvelle manière », et c’était vrai aussi bien pour le féminisme que pour la culture occidentale en général (2001, 2). D’Emilio and Freedman (1998) attestent qu’il y a eu, en Amérique du moins, de nombreuses révolutions dans les années 60, y compris des manifestations de jeunes, la libération homosexuelle et la libération des femmes. Steven Seidman (1991), pour sa part, réfute l’idée qu’il y a eu une révolution sexuelle, affirmant que c'était «plus de la rhétorique que de la réalité» et que cela prendrait des décennies (122). De plus, la révolution sexuelle, s’il y en avait une, a eu lieu dans des centres urbains parmi la jeunesse de classe moyenne (D’Emilio et Freedman 306). Il est également important de noter que le fait que le sexe devienne indisociable du plaisir a été largement influencé par le capitalisme de consommation et par le marketing du sexe et des modes de vies sexuels. Playboy de Hugh Hefner, publié pour la première fois en 1953, Sex and the Single Girl (1962) d’Helen Gurley Brown, et l’apparition de la pilule contraceptive dans les années 60 ont chacun renforcé la culture sexuelle libérale (voir, par exemple, D’Emilio et Freedman). C'est dans ce contexte de libéralisation sexuelle que les discours favorisant la permissivité sexuelle pourraient devenir culturellement intelligibles à grande échelle, en particulier parmi la jeunesse. Wendy Hollway (1984) décrit le discours de la permissivité sexuelle, qui, tout en contestant la monogamie, réaffirme le caractère naturel de l’hétérosexualité (234-236). En considérant les femmes comme égales aux hommes dans leurs besoins sexuels, leur libido et leur plaisir sexuel, il a néanmoins principalement promu et célébré une sexualité masculine (Hollway 235; Gavey 108). Ainsi, les femmes ont symboliquement perdu le droit de dire non à des relations sexuelles non consenties, qu’elles auraient pu éviter auparavant sous le couvert de la moralité (Gavey 108).
C’est alors que dans ce contexte de la fin des années 60, débuts 70, des féministes ont commencé à remettre en question cette soi-disant révolution sexuelle, en notant qu'elle n'avait pas réussi à faire le point sur les différences matérielles, les relations de pouvoir entre les sexes et, en effet, la politique de « ne pas le faire ». Les questions de sexe et de sexualité se sont avérées être au cœur de l’oppression des femmes; l’hétérosexualité en tant qu’institution s'est avérée, grâce à la sensibilisation, à l’organisation et à la théorisation féministes, un instrument dans le maintien de l’inégalité et de l’oppression des femmes. Si de nombreuses féministes ont célébré le sexe et la sexualité, cela n’a jamais été sans esprit critique, mais en prenant compte comment le pouvoir et l’inégalité structurent les relations « libérées » entre les hommes et les femmes.
Par exemple, des féministes du women’s liberation movement comme Anne Koedt (1968) et Ti-Grace Atkinson (1968, 1970) ont exploré les notions de liberté sexuelle des femmes en s’appropriant le clitoris comme symbole de l’autonomie et de la libération des femmes (Gerhard 2000, 449). Elles rejettaient la psychanalyse, lui préférant le travail e Masters et Johnson, elles ont répondu au tournant permissif de la culture en théorisant des formes de plaisir qui n'incluaient pas les hommes. Dans son classique féministe « The Myth of the Vaginal Orgasm » (1968), Anne Koedt a politisé ce qu’elle considérait comme le mythe de la frigidité des femmes, s'appuyant sur Masters et Johnson pour s’approprier le clitoris en tant que qu’organe du plaisir sexuel et de l'orgasme des femmes. Elle considérait à son tour la frigidité comme un outil patriarcal employé par les sexologues pour maintenir les femmes dans leur place sexuelle et sociale. Elle écrit:
“Les hommes ont généralement définit la frigidité comme l’échec des femmes à avoir des orgasmes vaginaux. [...] Plutôt que d’expliquer la frigidité féminine par les fausses hypothèses faites sur l’anatomie féminine, nos « experts » ont déclaré que la frigidité était un problème psychologique des femmes.” (38)
En outre, Koedt et Atkinson ont suggéré que l'orgasme vaginal était un mensonge politiquement opportun, un mythe, qui sert les intérêts du statu quo; Atkinson écrit dans « The Institution of Sexual Intercourse »(1970), que « l’orgasme vaginal est un excellent exemple de la manière dont les hommes oppriment et exploitent les femmes » (6). Pour Koedt, Atkinson et beaucoup d’autres de féministes lisant leurs travaux, le clitoris est devenu un symbole de résistance sexuelle et corporelle contre les experts du sexe et contre le patriarcat plus généralement, et une opportunité de connaître le corps en dehors des normes phallocentrées, de créer des nouveaux langages et paysages sexuels. Les féministes se sont ainsi accrochées au clitoris et se le sont approprié comme un symbole de la libération des femmes, de l’autonomie sexuelle et de la révolution féministe.
Alors que certaines féministes ont célébré la sexualité clitoridienne comme un outil pour donner de l’autonomie aux femmes, d’autres ont proposé l’asexualité ou le célibat comme stratégie pour atteindre l’indépendance des femmes et mettre fin à l’oppression patriarcale. La féministe Breanne Fahs a récemment commenté dans « Radical Refusals: On the Anarchist Politics of Women Choosing Asexuality » (2010) que les stratégies proposant l’asexualité ont souvent perdues dans les débats féministes, l'accent étant plutôt mis sur l'impasse polarisée du débat pro-sexe contre anti-sexe des années quatre-vingt (446). Elle soutient que l'asexualité, bien qu'ignorée en tant que politique sexuelle, est un « refus radical », une stratégie féministe convaincante et efficace. Fahs soulève des questions sensibles – « Et si les femmes arrêtaient définitivement d'avoir des relations sexuelles? » arguant qu'il s'agirait d'une stratégie féministe et anarchiste radicale pour défaire les institutions patriarcales et étatiques telles que la famille, la reproduction de la nation, et les dynamiques de pouvoir genrées (446-447).
Après Fahs, je vais maintenant me concentrer sur la l’asexualité politique de Dana Densmore, une féministe radicale et membre du collectif féministe de Boston, la Cell 16 et de Valerie Solanas, la grande outsider du féminisme. Si l’asexualité et le célibat ne figurent peut-être pas aussi largement dans les textes féministes de la libération des femmes que le clitoris, le fait qu'ils aient été explorés par deux féministes très différentes - Densmore et Solanas - suggère que l'asexualité et le célibat ont été imaginés, au moins par certaines féministes, comme des stratégies politiques féministes convaincantes et viables. Je citerai Densmore et Solanas pour montrer en quoi leurs textes perturbent les discours dominants sur la sexualité, à savoir l'injonction au sexe et le cluster hétéro-coïtal, ainsi que pour la manière dont ils imaginent des stratégies de célibat ou d'asexualité.
Le célibat et l'asexualité sont communément définit comme étant catégoriquement différents l'un de l'autre, en particulier dans le contexte de l'asexualité contemporaine, sur la base que le célibat est un choix et que l'asexualité ne l'est pas (parce que c'est un phénomène naturel du corps biologique ou de la psyché). Si Fahs fait également la distinction entre le célibat et l'asexualité (en conceptualisant le premier comme une stratégie temporaire et la seconde une stratégie permanente), elle le fait d'une manière qui dénaturalise fondamentalement l'asexualité car elle lui attribue une dimension de choix pour en faire un fondement pour une action politique et féministe. J'expliquerai ces frontières qui se dessinent entre le célibat et l'asexualité dans le chapitre suivant, mais pour le moment, j’aimerai suggérer que brouiller la distinction entre l'asexualité et le célibat est productif. C’est d’autant plus vrai dans le contexte de cette discussion puisque les féministes de la fin des années 60 jusque dans les années 70 ne semblent pas particulièrement préoccupés par la différenciation entre célibat et asexualité, théorisant les deux comme des choix politiques motivés par la perspective de la fin de l’oppression des femmes.
Avant de continuer, je voudrai saluer l'efficacité des formulations de la seconde vague féministe concernant le sexe, la sexualité et l’oppression féminine, si ce n’était pas déjà évident. Mais comme le notent Jo-Ann Wallace et Tessa Jordan (2011), les textes féministes de la deuxième vague sont couramment lus aujourd'hui comme à la fois dépassés et simplistes. Il leurs est souvent reproché qu'ils occultent les préoccupations liées à la race et à la classe; en conséquence, les concepts de la seconde vague tendent à créer une distance entre hier et aujourd'hui, eux et nous, et suggèrent peut-être même une marche (féministe) vers le progrès. Même si « [tous] les mouvements politiques, y compris le féminisme, épousent des idéaux sociaux et éthiques lorsqu'ils articulent leur vision de la bonne vie ou d'une société plus juste », je soutiens que de nombreuses idées féministes sont essentielles pour mettre en œuvre une transformation personnelle et sociale, et que les idées féministes sur l'asexualité, en particulier, peuvent aider à générer des philosophies et des pratiques politiquement engagées qui ne sont jamais aveugles sur les asymétries de genre.
Dana Densmore est l’une de ces féministes qui s’est engagée dans l’exploration d’une asexualité politique ou de célibat comme stratégie pour mettre fin à l’inégalité entre les sexes et à l’oppression des femmes. Densmore était membre du groupe féministe de Boston Cell 16, formé en 1968, qui a produit la revue féministe No More Fun and Games, et qui a nourrit l’idée du séparatisme et à l'abstinence sexuelle radicale (Fahs 2010, 448). Dans « Independence from the Sexual Revolution » (1971) et « On Celibacy » (1968), Densmore apporte plusieurs idées clés, qui restent culturellement pertinentes à ce jour, et qui sont antérieures, en un sens, aux travaux futurs sur la sexualité.
D’abord, Densmore ébranle l’injonction au sexe, c’est à dire que le sexe n'est pas entièrement un besoin corporel naturel, mais qu'il a été rendu central pour tout un chacun par une culture patriarcale. Par exemple, dans « On Celibacy » (1968), elle écrit « le sexe n'est pas essentiel à la vie, comme l'est la nourriture. Certaines personnes passent toute leur vie sans s'y engager du tout, y compris des personnes bien, chaleureuses et heureuses. C'est un mythe que cela rend quelqu'un amer, ratatiné, tordu » (264). Cela fait directement référence à un discours encore influent aujourd’hui, à savoir que le sexe est sain (psychologiquement et physiologiquement) et qu'une absence de sexe est en quelque sorte délétère. Dans « Independence from the Sexual Revolution » (1971), elle remet en question l’efficacité d’assimiler, pour le dire crûment, la baise à la liberté, affirmant de façon sardonique que « le sexe devient une religion », et que « qu’il nous est enfoncé dans la gorge » (58). Comme d'autres féministes de son temps, Densmore est sceptique quant au tournant permissif des années 60/70, “non pas [parce que] le sexe est mauvais et destructeur par nature”, mais au motif qu'il ne prend pas en compte l'oppression sociale des femmes et des violences sexuelles comme le viol et les agressions sexuelles (59). De même, elle se demande si le sexe est vraiment beaucoup plus excitant et agréable que d'autres activités: « Beaucoup de choses sont agréables sans que nous en venions à penser que nous ne pouvons pas vivre sans elles […] Je peux penser à certains aliments, certaines musiques, certaines drogues, qui donnent autant de plaisir physique que du bon sexe » (59). Ici, Densmore attire notre attention sur le caractère artificiel de privilégier le sexe par rapport aux autres activités, quand, comme elle l'écrit dans « On Celibacy », « Le sexe est en fait un besoin mineur, disproportionné, mal compris »(265).
Dans un second temps, Densmore remet en cause le cluster hétéro-coïtal et perturbe le récit téléologique du coït phalocentré. Elle écrit:
“Nous pensons que nous avons besoin de sexe, mais la question est très confuse. De quoi a-t-on vraiment besoin ? Des orgasmes ? Du rapport sexuel ? De l’intimité avec un autre être humain ? Des caresses ? De la compagnie ? De la gentillesse humaine ? Et en avons-nous « besoin » physiquement ou psychologiquement ?”
De cette façon, elle répond la question de ce qui compte comme sexe dans notre culture en explorant les motivations des femmes à s’engager dans des rapports sexuels, qui selon elle incluent l'amour, l'affection et la proximité. Elle n’est pas non plus la seule à s’interroger. Par exemple, la féministe Kat Millett questionne aussi le statut du coït dans Sexual Politics (1969) ,le décrivant comme un « microcosme chargé », qui « entre autres […] peut servir de modèle de politique sexuelle », et le dénaturalise comme «une longue série de réponses apprises» (23, 32). De plus, Densmore remet en question ce que Seidman (1991) a appelé plus récemment le passage à une « sexualisation de l'amour », ou la fusion discursive au cours du XXe siècle de l'amour avec le sexe. « Nous pensons que l’amour c’est l’amour sexuel, l'amour sexuel génital », se lamente Densmore, en dénaturalisant de l'amour comme sexe et en remettant en question le caractère naturel du sexe génital (1971, 60).
Enfin, Densmore suggère que le célibat est une stratégie possible pour remettre en cause la dépendance émotionnelle, sexuelle et sociale des femmes à l’égard des hommes et encourager l’autonomie, l'indépendance, et les liens avec d'autres femmes à la place. Dans « On Celibacy », Densmore reprend :
“Il ne s'agit pas d'un appel au célibat mais à l'acceptation du célibat comme une alternative honorable, préférable aux désagréments de la plupart des relations sexuelles entre hommes et femmes. Mais ce n'est que lorsque nous acceptons complètement l'idée du célibat que nous pourrons un jour nous libérer. (266)
Densmore soutient que l’augmentation de la fréquence des orgasmes féminins ou la reconnaissance de la capacité des femmes à avoir du plaisir sexuel sont insuffisantes pour un changement social substantiel, car le droit des femmes au plaisir n’est qu’un élément mineur de « l’oppression et du dénigrement générales que [les femmes] subissent dans le monde », et parce que l’oppression existe à plusieurs niveaux, « le problème n’est pas seulement l’orgasme » (1971, 57). Le sexe n’est pas un problème, non pas en soi pour Densmore, mais parce qu’il est présenté comme la voie de la libération, alors qu’il fait partie intégrante de l’oppression des femmes car il absorbe de leur temps et de leur énergie, augmente leurs chances de subir la violence et l'objectivation, et les maintient dépendantes des hommes. Densmore avance que le sexe est une perte de temps pour les femmes à cause de tous les soins, flirt et préparations qui y mènent, du temps perdue pour la libération des femmes (par exemple 1971, 56). Ainsi, « beaucoup de filles qui seraient les plus libres de se battre dans la lutte de libération féminine gaspillent une énergie précieuse » (56). De plus, le sexe est « la carotte qui nous garde à notre place » car il contribue à maintenir les femmes dépendantes des hommes pour leur plaisir et leur survie (1971, 58).
Dans ce contexte, le célibat est conceptualisé comme une option raisonnable, et une stratégie efficace pour gagner en indépendance vis-à-vis des hommes et rediriger du temps et de l’énergie vers les femmes. En ce sens, cela ressemble beaucoup au lesbianisme politique, qui est aussi souvent envisagé comme une pratique politique et féministe. Par exemple, Par exemple, « The Woman Identified Woman » (1971) de Radicalesbians recommande le lesbianisme aux féministes car qu'il permet « à nos énergies [de] couler vers nos sœurs et non vers nos oppresseurs » (83). Fahs soutient cependant que les explorations de Densmore et de la Cell 16 sur l'asexualité en tant que praxis féministe sont antérieures au séparatisme lesbien, contribuant à en établir les fondements (2010, 455). En outre, l'appel de Densmore au célibat devient, surtout pour l'asexualité, une méthode pour élargir les possibilités de relation, de telle sorte qu'elle explique dans « Independence from the Sexual Revolution » que « nous devons développer de nouvelles manières non sexuelles de se rapporter aux personnes, aux hommes comme ainsi que les femmes. L'obsession de la sexualité génitale, et pour le coït en particulier, nous prive d'un monde aux riches possibilités » (1971, 60). Ce n'est pas tant que Densmore prône une vie désexualisée, mais une canalisation de l’énergie mise dans le sexe et l’érotisme vers des activités autres que le sexe (1968). Finalement, le célibat pour Densmore implique plus que « ne pas le faire », il signifie également un mouvement vers une plus grande indépendance vis-à-vis de l’approbation des hommes et un rejet, peut-être, des outils et pratiques actuellement employés pour attirer l’attention et la validation des hommes: « vous devez être prêtes, alors, à être non seulement indésirable, mais également sexuellement repoussante pour la plupart des hommes, peut-être y compris tous les hommes que vous admirez actuellement » (1968, 267). Le célibat politique de Densmore encourage ainsi les femmes à réfléchir de manière critique au tournant culturel permissif, en leur donnant les moyens de tourner le dos aux hommes et à la validation masculine, pour construire une société nouvelle qui refuse de se contenter de moins que la libération complète des femmes.
Le tristement célèbre SCUM manifesto (The Society for Cutting Up Men)» (1967) de Valerie Solanas aborde également, bien que très différemment, l’asexualité comme une pratique radicale qui constitue un défi à la fois contre l’État et le patriarcat. Solanas est une figure contestataire radicale qui a intentionnellement rejeté diverses positions identitaires, y compris le féminisme, mérite néanmoins une considération féministe en raison de ses analyses singulières du patriarcat et de la marginalité des femmes (Fahs 2008). On se souvient d’elle le plus souvent pour avoir tenté d’assassiner Andy Warhol en 1986, James Harding soutiendra (2001) qu’il s'agissait d’une performance anti-art d'avant-garde et radicale, Solanas a également souvent été reprise et son travail réimprimé dans les milieux féministes, lui ouvrant un lectorat plus large ( Fahs 2008). Par exemple, Atkinson la définissait comme « la première et l’unique leadeuse des droits des femmes » et Florence Kennedy, « l'une des plus importantes porte-parole du mouvement féministe » (cité dans Fahs 2008, 596). Plus récemment, Fahs propose que Solanas nous oblige à prendre la question du féminisme radical plus au sérieux, à nous demander si « un projet « misandre » (quelque chose de constamment - et publiquement - rejeté par la plupart des féministes modernes) [peut] être utile, même sur le plan théorique ? » (2008, 593). Face à cela, elle conclut: « elle [Solanas] se moque des justifications nous-ne-détestons-pas-vraiment-les-hommes, on-est-pas-lesbiennes, on-se-rase-les-aisselles, on-est-pas-des-féministes-extrémistes. Elle cristallisait l’essence de ce qui dérangeait dans le mouvement féministe » (613).
Poussé par la sensibilité des questions que soulève Fahs, je lis moi aussi Solanas pour les idées qu’elle apporte à une politique féministe de l’asexualité. Son manifeste porte des idées particulièrement inventives qui bouleversent les discours hégémoniques sur la sexualité (ainsi que les pratiques de consommation, le contrôle social et comme le soutient Harding, la culture artistique); elle redéploie efficacement contre les hommes nombre des fictions culturels qui ont été racontés sur les femmes à travers l'histoire - y compris aujourd'hui -. C’est n’est pas un manuscrit sans contradictions, le SCUM proclame une « dissonance antagoniste », et est « consciemment disharmonieux et volontairement inassimilable », même s'il est politiquement radical et significatif pour le féminisme (Harding 148). Je vais d’abord interroger la façon qu’a le « SCUM » de diviser la société en trois groupes –les hommes, les « groovy SCUM women », et les filles à papa –. Ensuite, comme l’a fait Densmore, je lirai Solanas pour savoir comment elle défait les discours sexuels dominants, y compris l'injonction au sexe, le tournant permissif et le cluster hétéro-coital. Enfin, je me pencherai sur la réponse féministe radicale que propose Solanas et qui mettrait fin non seulement à l’oppression des femmes, mais signerait aussi la fin des oppresseurs - les hommes - en la situant plus largement dans le contexte de son projet SCUM.
Sarcastique et acerbe, Solanas divise la société en trois groupes de personnes: les hommes, les filles à papa et les femmes « groovy ». Solanas déclare que les hommes sont, entre autres, « entièrement viscéraux », « à moitié morts, des paquets taiseux », « d’un ennui absolus » (201), « des dildos ambulants », « psychiquement passifs » et « des femmes [s] incomplètes » caractérisée par leur « envie de chatte » (202). De plus, selon le manifeste, ils sont largement responsables de maux de notre culture, des institutions et des discours, de la guerre, de la violence et de la haine à la gentillesse, à la politesse et à la dignité, au système de travail, de l'argent, à la culture et au grand art. En effet, les hommes ont « un touché de Midas négatif, en ce sens que tout ce qu’ils touchent devient de la merde » (205). La seule supériorité masculine réside dans les « relations publiques » - ils « ont fait du monde un tas de merde » et convaincus les femmes de leur infériorité (202). D’un autre coté, les femmes ne se caractérisent pas simplement et sans ambiguïté par l’opposé de ces traits - et même si elles le sont, elles sont ensuite sculptées par la culture masculine sous d’autres formes, en particulier pour devenir des « filles à papa ». Les filles à papa - « passives, polyvalentes, respectueuses et admiratives du mâle » - s'adapte gracieusement à son rôle subalterne dans la société, sans faire trop d'histoires, et devient incapable de se voir pour ce qu'elle est - absurde, insipide (210). A l’inverse, peu de femmes conservent leur « grooviness » et peuvent être classées dans la catégorie SCUM, comme « confiantes, indomptables et à la recherche de sensations fortes » (211). Avant que je ne développe davantage la pensée du SCUM manifesto de Solanas, je vais pour l’instant examiner la manière dont son manifeste remet en cause les discours sexuels dominants.
D’abord, Solanas remet en cause, comme Densmore l’injonction au sexe, mais d’une manière remarquablement différente. Au début du SCUM, les hommes nous sont présentés comme des créatures vraiment répugnantes, et Solanas sattarde pour décrire leur obsession pour le sexe, dénaturalisant par hyperbole ce que Hollway a appelé le discours sur la pulsion sexuelle masculine - que les hommes ont besoin de sexe, et que par conséquent leur libido est hors de leur contrôle. Solanas écrit que « le mâle est obsédé par la baise; il nagera dans une rivière de morve, pataugera au fond de ses narines à travers un kilomètre de vomi, s’il pense qu’une chatte amicale l’attend »(202). Cet humour hyperbolique, bien que peut-être difficile pour les oreilles (de certains), rend effectivement ridicule les discours sur les pulsions sexuelles masculines. Solanas détourne également la logique culturelle qui assigne les femmes à un rôle passif, et les hommes, actif, en affirmant que « la baise est donc une tentative désespérée et compulsive de prouver qu'il n'est pas passif, pas une femme » et transforme l'envie freudienne du pénis en une « envie masculine de chatte » (202). Ces raisonnements sont des déconstructions et des retournements de la binarité « passif/actif », ainsi qu’une affirmation de la dimension culturelle des savoirs discursifs qui réduisent les femmes à être inférieures aux hommes, absentes. Cependant, la clé de voûte d’analyse de Solanas vis à vis du sexe réside dans le fait qu’elle le rejette car inutile et chronophage. Son rejet du sexe est fondé sur un rejet plus large de la société, de la culture, des hommes et de tout ce qui est créé par les hommes - vraisemblablement, à peu près tout. Bien que je revienne là-dessus plus loin, pour l'instant je tiens à souligner que dans le manifeste, le sexe est présenté, comme dans chez Densmore, comme une perte de temps: « le sexe […] est une expérience solitaire, non créative, un gaspillage de temps grossier » (Solanas 213). Mais contrairement à Densmore qui prend soin de ne pas tomber des une rhétorique anti-sexe (indiquant, par exemple, que le sexe n'est pas « par nature mauvais ou destructeur »), Solanas ne se prive pas de décrire le sexe comme destructeur - elle le qualifie d’« animal » et « [de] refuge des insensés » (Densmore 1971, 59, italiques dans l'original; Solanas 213). Malheureusement, Solanas n’explique pas en profondeur pourquoi le sexe est si central, c’est à dire, en quoi le sexe lie les femmes aux hommes et qu’il s’agit d’une mauvaise utilisation de leur temps, du temps qui pourrait autrement servir à « groover ». De plus, comme Densmore, Solanas assimile sexe à sexe hétéro et ne célèbre ni ne critique le sexe lesbien, et il est donc difficile de savoir si elle imagine le sexe lesbien comme tout aussi indigne de son temps.
Dans un second temps, la stratégie employée par Solanas pour critiquer le tournant permissif de la culture passe par l’invocation de la figure du hippie, le symbole, par excellence, de la culture alternative des années 60 et de la révolution sexuelle. Pour Solanas, « le hippie est tenté par la communauté principalement dans la perspective de toutes ces chattes faciles » (208). Le hippie n’est donc pas différent des autres hommes en cela qu’il est guidé par son pénis. Fahs (2008, 2010) et Harding (2001) expliquent toutes deux que Solanas est résolument anti-institution, anti-autoritaire et anti-capitaliste et que cela est aussi perceptible dans son hostilité envers la figure par excellence du mode de vie alternatif des années 60. De plus, Solanas affirme que les mâles sont incapables d’une réelle révolution sociale car « l’homme au sommet veut le statu quo, et tous les hommes à la base veulent seulement être l’homme au sommet »(210).
Troisièmement, le « SCUM Manifesto » trouble également des aspect du cluster discursif hétéro-coïtal en remettant en cause la culture du couple et ce que Seidman (1991) a appelé la “sexualisation de l’amour”, ou le fait d’amalgamer le sexe à l’amour. Solanas insiste sur le fait qu’« une réelle communauté consiste en des individus - pas de simples membres d’une espèce, ou de couples », plus tard dans son manifeste plaide pour une « explosion du couple » SCUM (207, 2018). En cela, elle sape brièvement l’organisation sociale de l’amour comme basée sur la primauté du couple. Elle invalide aussi la sexualisation de l’amour en affirmant que « l’amour n’est pas dépendant du sexe, mais de l’amitié » (211). Et puisque cette amitié est uniquement possible entre deux femmes - c’est-à-dire entre « deux femmes sur d’elles, en roue libre, indépendantes et groovy » (évoquant encore le lesbianisme politique) - la société qu’elle envisage est basée sur les amitiés polyamoureuses, potentiellement asexuelles, entre femmes (211).
C’est l’asexualité qui est envisagée par Solanas comme une composante d’une révolution et d’une stratégie efficace pour complètement démanteler le patriarcat. Pourtant, à la différence de Densmore qui prend sérieusement la tâche de la révolution féministe, Solanas ne (semble pas) le faire. La critique du sexe et de la stratégie du célibat par Densmore est fermement basée sur ce que je comprend comme une sorte d’optimisme féministe, le sentiment que le monde non seulement a besoin de changer mais aussi qu’il le fera réellement avec un effort féministe organisé suffisant. Solanas, de l’autre côté, parle d’une position nihiliste, ne croyant pas en la possibilité de changement, alors même qu’elle plaide pour un genre plus radical de renversement du système.
La solution qu’elle propose pour renverser la société et la culture masculine est la suivante. Dans le manifeste, SCUM - les « femmes confiantes, qui swinguent, qui amatrices de sensations fortes » - cherchent à créer « une société féminine [...de] femmes funky qui se groovent les unes les autres » (211). Dans le but de faire advenir le vrai SCUM sur Terre, les hommes doivent être éliminés de quelque façon possible, et leur culture masculine doit de même être exterminée. Une partie de cette stratégie pour éliminer les hommes est l’asexualité, la fin de la reproduction des hommes. En plus d’aider à l’élimination des hommes, l’asexualité redirige également l’attention des femmes SCUM vers d’autres buts, notamment la refonte de la société. Les femmes SCUM,
“Ces femmes le moins ancrées dans la « Culture » mâle, les moins gentilles, ces âmes crasses et simples qui réduisent la baise à la baise, qui sont [...] trop égoïstes pour élever des enfants et des maris [...] ces femmes sont cool et relativement cérébrales frôlent l’asexualité. (213)
Puisque le SCUM est « impatient », il commencera à agir immédiatement par la désobéissance, le retrait de la force de travail, et un refus de prendre part au système monétaire. La « force fuck-up » commence son « détravail » via divers moyens de désobéissance civile incluant « foutre en l’air leur travail », détruire des objets inutiles (quasiment tout ce qui a été créé par les hommes, « le Grand Art » inclus), prendre possession des ondes, « l’explosion des couples« », et, finalement, tuer tous les hommes (218).
Solanas écrit : « Si toutes les femmes quittaient simplement les hommes, refusaient d’avoir affaire à eux de quelque manière que ce soit - tout le temps, tous les hommes, le gouvernement, et l’économie nationale s’effondreraient complètement », et c’est l’objectif ambitieux et fictif du manifeste SCUM, une refonte complète de la société via une annihilation complète de la société masculine et de sa culture (217). L’asexualité est centrale à cela, car elle brise les liens intimes des femmes avec les hommes, leurs oppresseurs, et donc libère les femmes pour s’engager dans la construction d’un nouveau monde et d’un nouveau (dés)ordre mondial. C’est une proposition révolutionnaire non réformiste puisque le « SCUM est contre le système tout entier, l’idée même de la loi et du gouvernement. Le SCUM cherche à détruire le système, pas atteindre certains droits au sein de celui-ci » (220). Les hommes seront annihilés et également arrêtés d’être reproduits, bien sur, mais la note finale de nihilisme et l’indice que Solanas n’a peut-être pas trop d’espoir dans la perspective d’un changement social substantiel est dans l’assertion du manifeste que les femmes également cesseront à terme d’être reproduites. « Pourquoi produire même des femmes? Pourquoi devrait-il y avoir des générations futures? Quel est leur but? » (217). Je fais la supposition que ce nihilisme sert à amoindrir la notion de révolution, questionnant la possibilité de changement social. Aussi, il rend la stratégie de l’asexualité particulièrement appropriée : « un agenda politique asexuel avance la libération des femmes dans la direction du nihilisme » (Fahs 2010, 455).
Comme Densmore, alors, Solanas envisage des stratégies asexuelles radicales pour mettre fin aux problèmes systémiques. La solution pratique du célibat de Desnmore comme la prise de contrôle nihiliste du monde de Solanas, de laquelle l’asexualité est une part intégrale, sont ancrées dans une insatisfaction féministe avec l’inégalité genrée, l’oppression sexuelle et sociale des femmes, et un monde qui semble être dirigé par des hommes et pour des hommes. « Ne pas le faire » devient une arme féministe utilisée par deux féministes différentes vers un ensemble de buts similaires : briser les liens intimes des femmes avec les hommes, établir l’autonomie sexuelle et sociale des femmes, rediriger le temps et l’énergie des femmes vers des projets féministes et des amitiés centrées vers les femmes, et travailler à un monde dans lequel la libération féminine est manifeste. En soulignant ces deux stratégies asexuelles différentes et néanmoins similaires, j’espère avoir démontré à quel point « ne pas le faire » peut être significatif pour les politiques féministes.
Enfin, avant de conclure ce chapitre, j’aimerais discuter brièvement de trois autres articulations de l’asexualité et du célibat féministe. Les oeuvres courtes de Jessie Bernard (1972), Myra Johnson (1977), et Candace Watson (1987), bien que ne rentrant pas complètement dans les décennies de la libération des femmes, démontrent néanmoins que les stratégies de célibat et d’asexualité, bien que marginales dans la pensée féministe, ne sont pas exclusive à Densmore et Solanas. Même si elles n'ont peut-être jamais été un élément central féminisme mainstream, l’asexualité est pertinente et significative pour le féminisme, comme le démontre Fahs dans ses travaux récents (2010).
Premièrement, la sociologue féministe Jessie Bernard a publié « Women, Marriage and the Family » comme chapitre dans Intimate Lifestyles (1972) et exploite quelques-unes des possibilités du célibat comme un outil politique féministe. Elle décrit les féministes radicales comme « fomentant [...] une toute nouvelle révolution sexuelle [...qui] n’est pas la révolution désormais périmée dont les magazines féminins se préoccupent encore - la révolution du travailler-mieux-pour-atteindre-l’orgasme - mais une révolution qui la transcende » (383). Comme Densmore et Solanas, elle est sceptique face aux promesses et opportunités que la révolution sexuelle présente aux femmes. Aussi, comme Densmore (qu’elle cite), elle a l’espoir des changements que le féministe va apporter au monde, comme permettre un déclin des models de femme au foyer, du mariage, et du travail reproductif. Bien que le travail de Bernard « n’est pas un appel au célibat en soi » c’est une défense sympathique du célibat comme « une alternative honorable » préférable à beaucoup de relations hétérosexuelles (384). Bernard reconnaît le défi que cela présente à l’injonction au sexe, au mariage, et à la reproduction, saluant « les femmes radicales » pour « faire ce qu’elles pensent doit être fait » (384, 385). Bernard termine son court chapitre avec la phrase suivante : « Dans 50 ans nous regarderons en arrière et nous demanderons ce que nous pensions si avant-gardiste à propos de ces femmes. D’ici là, cela semblera si évident » (385). Que quarante ans soient passés, et que ces textes que j’ai discutés continuent à être vus comme radicaux, pourrait donc suggérer que le projet du célibat féminin ou de l’asexualité n’est pas du tout désuet.
« Asexual and Autoerotic Women: Two Invisible Groups » de Myra T. Johnson, publié comme un chapitre dans The Sexually Oppressed (1977) est un autre texte des années 70 qui reprend l’asexualité dans une perceptive féministe. Johnson fournit peut-être la première considération la plus approfondie de l’asexualité en s'appuyant sur le chapitre de Bernard, ainsi que les textes de Densmore, Koedt, Atkinson, Jill Johnston et d’autres féministes (mais pas Solanas). Précédant de plusieurs années les travaux de l’étude scientifique de l’asexualité, elle utilise à la fois le vocabulaire du mouvement de libération des femmes et soulève des questions qui sont couramment explorées dans les communautés asexuelles d’aujourd’hui. Premièrement, elle reconnaît que les asexuel-le-s, et les femmes asexuelles en particulier, sont opprimé-e-s du fait de leur orientation sexuelle (comme le titre du volume l’indique) parce qu'ils sont rendus culturellement invisibles; elle écrit que les femmes asexuelles sont « opprimées par le consensus qu’elles n’existent pas »(97). Johnson explore également la possibilité que l'asexualité soit « consciente politiquement » et s'engage dans un travail similaire aux autres auteurs dont j'ai discuté, en bouleversant la notion de révolution sexuelle libératrice et remettant en question l'injonction au sexe (103). En étudiant des magazines féminins, elle démontre que de nombreuses femmes se sentent obligées d’avoir des relations sexuelles en raison du tournant permissif. Par exemple, une lettre d'une lectrice de Glamour en 1974 indique: « S'il vous plaît, quelqu'un mentionnerait-il le fait que la vie peut être belle, pleine de sens, riche et satisfaisante avec ou sans sexe? » (cité dans Johnson 101). Dans le même temps, dans les travaux contemporains sur l'asexualité, comme celui de Scherrer (2008, 2010a, 2010b), Johnson remarque également l'absence de langage pour décrire l'asexualité - « il semble y avoir peu de mots vraiment appropriés dans le Langue anglaise pour décrire la personne qui [...] semble préférer ne pas se livrer à une activité sexuelle »(97). Le chapitre de Johnson, bien qu’il ne considère pas que l’asexualité soit une stratégie radicale de la même façon de Densmore ou Solanas le font, situe effectivement l’asexualité dans le contexte du tournant permissif et pose des questions sur commet les femmes asexuelles sont rendues invisibles culturellement.
Le dernier exemple que je voudrais traiter ne peut guère être considéré comme relevant du féminisme de seconde vague. Publié dans un des premiers numéros du « Forum » d'Hypatia, « Celibacy and It’s Implications for Autonomy » de Candace Watson (1987) reste néanmoins un texte féministe radical qui s'inscrit dans le contexte de cette discussion. Watson redéfinit la notion de célibat pour y inclure l’autoérotisme ou la masturbation. Elle soutient que pour les femmes, un célibat qui inclut la masturbation met sérieusement en question l'hétérosexualité, la reproduction « au service de l'espèce », et permet l'autonomie corporelle (158). Cette autonomie est « tout sauf un choix personnel » car elle est largement prédéterminée par « les circonstances et la culture [qui] interviennent pour façonner nos destinées économiques, émotionnelles et sexuelles » (157). Le célibat, couplé à la masturbation est une stratégie féministe que Watson considère comme accessible et possible pour de nombreuses femmes mais aussi « potentiellement radicale [dans son] invisibilité » (158). Ainsi, contrairement à Johnson, elle imagine l'invisibilité du célibat comme l'une de ses possibilités radicales. Watson célèbre un célibat complété par la masturbation, en tant que tactique féministe raisonnable, accessible et efficace, qui permet l’autonomie sexuelle des femmes dans un contexte social où cela n’est pas souvent possible.
J'ai expliqué dans cette section que l'asexualité et le célibat ont la capacité d'être des tactiques féministes politiquement significatives et que c'est effectivement la manière dont elles ont été adoptées par les féministes à la fin des années soixante et soixante-dix (et dans le cas de Watson (1987). ) et Fahs (2010), plus récemment également). Non seulement les féministes telles que Densmore et Solanas déploient l'asexualité et le célibat d'une manière qui perturbe et démantèle les discours dominants sur la sexualité, mais elles le font aussi intentionnellement, c'est-à-dire en gardant à l'esprit des objectifs politiques féministes. Bien que ces objectifs soient divers, ils incluent la fin de l’oppression des femmes et de l’inégalité entre les sexes, la subversion des systèmes de pouvoir et de privilège, affirmer l'autonomie corporelle et remettre en question les modèles actuels de production et de reproduction. En prenant très au sérieux les écrits de Densmore, Solanas et d'autres, je suggère que nous pouvons apprendre des explorations passées de l'asexualité, en les utilisant pour élargir les notions, les compréhensions et les pratiques actuelles de l'asexualité contemporaine. S'il n'est pas vrai que les asexualités féministes dont je viens de parler ici ne soient pas directement liées à l'asexualité contemporaine en tant que catégorie d’identité sexuelle, il est vrai que l'asexualité contemporaine gagnerait à une réflexion approfondie sur des textes tels que ceux dont j'ai discuté (et peut-être bien d’autres qui n’ont pas encore été « découverts ») parce qu’ils nous rappellent les implications radicales, politiques et féministes de « ne pas le faire ».
à chaque fois qu'il sera question de sexualité/d'asexualité des femmes/féminine, cela se rapportera à la sexualité des femmes cis. ↩︎